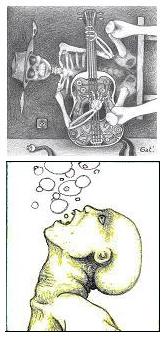-
Par Gatrasz le 9 Janvier 2013 à 04:23

Fond sonore : [ Six By Seven - Candlelight ]
Je marchais dans la nuit, ce fichu 31 décembre aux environs de la Fin des Temps. Tristesse. Pour un soir de fin d'année, c'était plutôt sinistre, les rues désertes et froides, les quelques silhouettes que je croisais, pressées de disparaître dans l'ombre qui les avalait, bondissant comme des feuilles mortes emportées par un vent violent vers leur destin funeste et répugnant de fragments putrescibles. Je traçais ma route en espérant qu'ils crèvent, se dissolvent dans le passé, loin derrière, comme les souvenirs sales d'évènements qu'on avait pas souhaités. Je les oubliais aussitôt, heureux de ne pas avoir à les connaître ; je fixais devant moi le goudron rapiécé de la rue vide de bagnoles et de toute vie qui en vaille la peine, mouillée par la pluie qui crachottait sans parvenir à laver complètement les souillures et les quelques cadavres qui tombaient ça et là des fenêtres. Un monde comme ça ne finit pas proprement, il se désquame, se décompose, il perd de l'huile et se répand, dégueulasse jusqu'au bout. J'avais perdu tout idéal de pureté, tout espoir d'échapper à la décrépitude ambiante ; et pourtant je m'en allais, tout droit, le plus loin possible de tout ça. Je filais à travers la ville géante, petit poisson dans la grande rivière qui charrie l'immense masse amorphe de chairs pourries que laisse la toute fin des choses, remontant vers des aubes anciennes, imaginaires et complètement chimériques. Le lac des origines, la source d'eau claire jaillissant au sommet d'une colline verdoyante, ronde comme le sein d'une vierge... Mirages, fantasmes crétins de rêveur naïf, trop facile à berner ; mais conscient en même temps de la vacuité du rêve et de la mauvaise qualité de l'illusion, client tout de même parce que ça vous tient en mouvement de croire, d'essayer de croire. Choisir d'y croire quand même, par principe. Je voulais penser qu'au bout d'une rue, d'une avenue, d'un de ces Grands Boulevards éclairés jadis de mille lumières et aujourd'hui ternis par les lois nouvelles sur l'économie d'électricité, il y aurait peut-être quelque chose ou plutôt...rien. La fin géographique, le début de la vaste solitude inoccupée du monde sauvage ; même si je savais bien, au fond, que ça n'existait pas, c'est-à-dire plus, et depuis bien longtemps.
Elle observait, par la fenêtre, mon périple idiot ; sirotant une coupe de champagne, les fesses posées de travers sur le rebord de la fenêtre. Elle fit coulisser la vitre, recevant en plein visage une bouffée de vent frais et humide. Le souffle d'un spectre qui aurait pris l'eau, pensa-t-elle, en s'habituant lentement aux frissons dans sa petie robe bleu électrique. Elle me suivait de haut, comme on observe un cafard sur un mur blanc, se repérant aux lumières qui s'allumaient sur mon trajet et s'éteignaient après - encore un méfait des mesures d'économie. La lumière vous suivait partout, vigilante et collante, et on pouvait vous regarder cheminer depuis les hauteurs, les structures, les bâtiments. Toute fuite au hasard était vouée à l'échec, la trahison immédiate. Elle enregistrait mon trajet dans sa mémoire, buvant sa coupe à petite gorgées distraites, et je n'essayais même pas d'écrire quelque chose. Je voulais partir droit devant, loin, au travers de l'enchevêtrement tortueux de voies parfois centenaires. Je serpentais comme une bille dans un labyrinthe, bing, bing, par rebonds.
J'avançais toujours, traversant la ville sans fin ; une cité qui ne s'arrêtait jamais de croître, qui avait depuis des lustres bouffé l'espace disponible autour d'elle et croissait maintenant à la verticale. Plusieurs kilomètres au-dessus, des gens m'observaient peut-être de leur living-room, en se demandant pourquoi un unique individu jugeait bon de tracer son chemin futile à cette heure, si près de l'anéantissement total qui supprimerait toute vie, tout but, tout intéret à se déplacer. On mourrait là, à sa place, bien tranquille dans la certitude de la fin égalitaire et instantanée du monde, programmée par on-ne-sait-qui dont la rassurante omnipotence garantissait de toute erreur, de tout ratage dans la cessation des actualités. Certains avaient peur et se cachaient, d'autres attendaient en buvant des cocktails que les horloges s'arrêtent de compter les secondes, avec un brin d'euphorie. Pour un peu, ils auraient fait l'amour une dernière fois, comme les désespérés ; mais ç'aurait été risquer de laisser passer l'instant, l'ultime seconde, effacée dans le flou d'un début d'orgasme raté...non. Plutôt attendre. Regarder pour se distraire les lumières qui clignotent et s'éteignent dans la nuit de ce Nouvel An qui ne viendra jamais, avorté sans avoir commencé par une quelconque lubie du Divin. Et ce pauvre con qui s'enfuit sans demander son reste, et qu'on voit à des kilomètres parce que l'oeil de la ville le suit, l'éclaire, le désigne à la vindicte, à la moquerie populaire des condamnés au sang froid comme des reptiles. Certes, j'aurais pu prendre le métro ; à une époque, j'aimais bien, quand il était encore sombre et froid, vestige animé des catacombes depuis longtemps comblées. Mais c'était devenu un gigantesque tube néon, habillé de lumière et d'écrans simulant au plafond des oiseaux, des nuages sur fond de ciel d'azur ainsi qu'on en voyait plus, même dehors, même au sommet de la plus haute des tours d'immeubles de la ville-monde. Un univers souterrain honirique, scripté, programmé, où tout était chaud, sec et publicitaire. Les vitres-écrans des rames de métro t'accompagnaient de leurs messages dérisoirement consuméristes - penser à renouveler votre abonnement annuel à votre marque de soda préférée. Cadeau à la clef. Tous ces trucs à te faire bander, jusqu'à ce que tu tombes d'inanition, cerveau vidé du sang qui s'accumule aux extrémités pour toucher, activer, jouir de tout et de rien parce que c'est bien, c'est la mode, c'est hype. Mais jouir en pleine lumière, ç'a jamais été mon truc. Alors j'en reviens à la rue, la nuit ; reste encore ça qui n'a pas tellement changé. Mains dans les poches, bonnet vissé sur la tête, je fends l'espace de ma petite carcasse noire au visage blanc, pestant contre les flaques et contre tout ce qui passe à ma portée. Contre la fin qui n'arrive pas, contre l'horizon qui se renouvelle et s'emplit de toujours plus de murs et de lumières, au lieu du vide obscur que je cherche et qui n'est plus, maintenant, qu'une fantaisie de milliardaires. Une semaine dans les étoiles...
Tout là-haut, elle suivait mon errance avec application, curieuse sans trop savoir de quoi. Oh, Dear... Se reflétait sur ses yeux la ligne brisée du chemin que j'avais parcouru, brillant en reflet, même après que les lampadaires municipaux se fussent éteints. I'm in love, songeait-elle. Mais de quoi ? De ce cheminement vague et sans aucun sens ?
Certainement pas de moi. Je ne savais pas, je ne voulais pas savoir. J'en voulais trop au monde pour prendre le risque de m'arrêter ; j'avais trop peur de sa masse critique prête à s'effondrer sur ma gueule comme une vielle cathédrale qui voudrait piéger pour l'éternité ses derniers adeptes apeurés, tentés par l'attrait maléfique des liturgies extérieures mais que la crainte et l'instinct grégaire ont gardé cachés sous ses voûtes de pierre. J'avais préféré la fuite irrémédiable dans un Univers qui sans cesse se déplace et te suit, se recompose et te perds un peu plus à chaque pas. M'échapper comme une bille entre les doigts huileux d'un Destin dans les filets duquel, forcément, la gravité te fait retomber. Mais qu'importe, tu ne t'arrêteras jamais ; car au fond, tu as trop peur que cet Univers t'écrase, te dépasse, et puis qu'il continue sans toi.
Et elle me regardait toujours. J'avais froid. Elle se pencha un peu, pour mieux voir ; une fine coupe de cristal vint s'écraser à mes pieds, dans un tintement presque irréel. Elle écarquilla les yeux ; je levai le nez au ciel. Au-dessus de moi, il y avait la nuit, et les dernières bouffées de chaleur prises dans mon manteau montaient comme un fin nuage de vapeur.Gatrasz.
 3 commentaires
3 commentaires
-
Par Gatrasz le 6 Janvier 2011 à 02:04(Dessin : plus tard)Fond sonore : [Fields of the Nephilim - New Gold Dawn]
J'ai foiré. Oui, il fallait bien que ça arrive un jour ; encore. Pourtant j'y croyais, cette fois : j'avais le marteau en main, les machines bien rangées au bord du chemin, et retrouvé momentanément la boussole. Mais il a fallu que quelque chose cloche, un réglage, un bout de roche, que sais-je ? Un boulon dans ma tête, plutôt. Pourquoi ai-je voulu sonder les abysses ? Pour y trouver du pétrole, peut-être ? Bien piètre excuse, me direz-vous, et vous aurez raison. Assez de noir ici autour, assez d'espoirs perdus... Non, c'était vraiment pas le jour de balancer mes ondes, mes rafales d'infrasons en faisceau serré. Je n'ai pas regardé les étoiles, et je n'y ai pas lu l'alerte, la configuration maudite que je connais pourtant si bien ; le symbole était là, sous mes yeux, tout pantelant et le regard moqueur. Il savait, le fichu Destin, et il m'a laissé sournoisement dérégler mes instruments. J'ai tout envoyé, la sauce, le jus, l'électricité : la foreuse et le gravimètre vibraient comme des désaxés, j'avais même sorti le magnétomètre à protons et le canon à air comprimé...
A présent, je suis comme un idiot sur mon bloc basculé, et tout tourne et s'élève autour de moi ; d'une rafale perdue, j'ai dû réveiller le Dieu-Poulpe au nom sombrement connu. J'ai trouvé au gré d'un rebond sa retraite révélée par la configuration stellaire, j'ai libéré des forces en sommeil depuis l'ère Primaire et peut-être bien plus encore. Cloué sur mon rocher, tout bouillant de fusion pas tellement partielle, je sens à peine encore la légèreté de l'air de ce matin sur le fantôme de mes épaules : passé proche mais si lointain déjà, inaccessible. J'aimerais n'avoir pas trouvé la fiche de la prise américaine, n'avoir pas su brancher le RS-137... Mais si ; pour une fois que j'avais compris quelque chose. Maintenant les arbres ont des bras distendus comme les fantômes de mes cauchemars, et d'autres détails que jamais je n'aurais su rêver, même si j'avais voulu ; je vois au loin les anciennes cités qui fondent, et s'en écoule un magma verdâtre qui reconstitue, ainsi que je le redoutais, la chose ignoblement tapie dans les sédiments... De grès verts ou de briques rouges, rien qu'un grand réservoir où sommeillait l'interdit, celui qui s'élève et sourit de mes crétineries sans nom, ses tentacules mêlés aux nuages graisseux qui couronnent et bafouent d'un même coup de tempête le jour impromptu de ma chute. En vrille, s'il-vous-plaît ; j'espère qu'il y aura de l'alcool, là où j'irai...FIN 3 commentaires
3 commentaires
-
Par Gatrasz le 2 Décembre 2009 à 16:27
[Eric Elmosnino et Dionysos - Nazi Rock] BOF "Gainsbourg (Vie héroique)
<script src="http://player.alloclips.com/oneclick_adv.js"></script> <script type="text/javascript"></script>
(Un peu surbooké mais la suite arrive; en attendant, un lien vers une reprise de Gainsbourg par mes préférés de la scène française : Dionysos, à voir sur scène au moins une fois dans sa vie ! Et une chanson tout à fait sympathique, que les initiés du grand Serge apprécieront :)P.S. : il existe aussi une video géniale du making-of, Rue Verneuil en pleine nuit et...tout en silences ;) 1 commentaire
1 commentaire
-
Par Gatrasz le 1 Novembre 2009 à 17:19Fond sonore : [Tinariwen - Tenhert (La Biche)](J'ai un peu de mal à poster, ces temps-ci ; mais aujourd'hui ça marche^^ Voici un petit texte bien ciblé, peut-être que vous reconnaîtrez ; je l'ai enrichi d'un petit hommage à Saint-Ex, l'écrivain aviateur, et à plein d'autres que je ne citerai pas...)
Un jour que l’avion de mes rêves avait pété un boulon, que j’étais à mille lieues de tout secours possible (même spirituel), je dormais sous le sable en baignant dans la certitude que rien de pire ne pouvait arriver. Assailli de rêves atroces, je montai m’asseoir sur la dune dans la nuit glacée du désert ; et là, frissonnant comme un nourrisson atteint du H1N1 qu’on aurait mis dans le bac à glaçons - pour conserver le virus - j’attendais la navette universelle qui vient immanquablement, tous les matins, ramasser les détritus et les déchets dans mon genre. Ah, si j’avais eu une clé à molette, tout eût été différent...
Mais non. Et, m’impatientant d’être finalement reconnu par le chauffeur aveugle de la navette comme un mécréant valable, j’avais dessiné sur le sable…un mouton. Un sale petit mouton noir, planqué dans un tiroir-caisse. Vint un Prince, sans transition. Pété d’oseille et de champagne, montre d’or au côté comme un quinquagénaire. Dorure au vent, avec l’air d’être né coiffé du portefeuille d’un président. Et des dents comme des haches, coupant les mots des autres et cisaillant les oreilles avec les siens... Scooter en rade sur l’épaule gauche et saluant du bras, bien éduqué quoi. Doté du pouvoir d’animer la poussière, j’aurais pu lui dessiner un mouflon, cornes spéciales anti-derrière bordé de nouilles, ou bien l’atteler d’un trait dans le sable à son deux-roues maudit ; mais je vis avec un pincement au cœur qu’il s’était payé la plus belle rose du jardin, direct, et de dépit je (me) crashai sur la dune. L’autre empaffé de prince me regarda en biais, mais je le mis en fuite à coups de P-38 (ici ou là).
Revenu à ma solitude, je vidai dans le sable mes dernières cartouches ; et puis je m’en allai avec mon arme vide, laissant le pouvoir (trop) visible et matériel à cette tête de con. Mes héros à moi sont plus sanglants, peut-être, mais au moins ce sont des poètes. Je tirai donc mes marrons du feu pour m’en aller conquérir, tout seul, ce qu’on appelle encore, et pour un moment, la Terre des Hommes...(Si j'avais eu le temps, j'en aurais peut-être fait une chanson ; mais voilà...je l'ai pas eu !) 3 commentaires
3 commentaires
-
Par Gatrasz le 28 Janvier 2009 à 14:35
 (Comme j'ai la flemme - et surtout pas le temps - de refaire un dessin, j'extrais ceci de mon projet BD en cours, j'espère que ça vous ira :)
(Comme j'ai la flemme - et surtout pas le temps - de refaire un dessin, j'extrais ceci de mon projet BD en cours, j'espère que ça vous ira :)
Abandonné de tous, je m'assieds sur les marches pour rattacher, à grand-peine, mes lacets ; le pinard du troquet m'en a mis un sérieux coup, dis-donc. C'est alors que j'avise Justine se fumant une cigarette au coin de la rue, vendant effrontément mes secrets à son benêt de petit ami. On lira demain que je suis bredouille en matière de Durand. Mais qui est-ce, nom d'un chien ?
Je reste là, les bras ballants, sur les trois marches ; plus tard, sur ma gauche, un brouhaha, comme toute une troupe d'apaches qui se feraient discrets. Et je les vois passer dans la ruelle, loin sur ma gauche : Durand ! Ça y est, je me souviens ; un bel enfoiré, celui-là, doublé d'un grand malade. Un type qui faisait des casses avec des sbires habillés en soldats pour effrayer son monde. Ce n'est pas de la prison qu'il s'est tiré, mon salaud, c'est de l'asile ! Aussitôt, je ma planque dans un renfoncement ; les aliénés - surtout en équipe - passé deux heures du matin, très peu pour moi... Je finis par me geler dans mon trou ; je vide ma vessie dans l'ombre comme un vieil ivrogne, puis je sors et me carapate gentiment. Pas de bol, je me colle à...Henry Durand. Qui me reconnaît, en plus ! Il se met à hurler comme un possédé : « Je le savais ! Salopard, les journaux avaient dit que tu traînerais ici ! ». Je maudis les canards et m'enfuis dans la nuit, poursuivi par le siphonné qui refuse de lâcher son os (c'est à dire, le mien). Une sacrée dent contre moi, qui l'avais oublié. Il voulait peut-être que je lui écrive, à l'hôpital ?
Abrité pour souffler dans l'escalier qui monte à un petit square, je le vois enfin s'éloigner, agitant les bras et vociférant avec désespoir. Je meurs d'envie qu'un riverain lui balance quelque chose du haut d'une fenêtre, pour le faire taire... Si l'aube le surprend comme ça, il ne courra pas longtemps : mais ce n'est plus mon boulot. Je me retourne pour grimper les marches fraîchement cimentées, quatre à quatre, et manque de mourir de trouille en me heurtant à quelqu'un qui arrive derrière. « Salut, dis-je, je suis l'alcoolique du coin, je ne fais que passer ». L'autre sourit, gratte les poils de son menton et me répond, l'air sérieux : « Moi, c'est la jeune fille du bout de la rue, je reste pas non plus ». Et il se défile sans courir, très correct en fin de compte pour un taggueur à casquette. Je change prestement de quartier, tombe sur une avenue qui commence à s'illuminer. Devant moi, le poste de la Croix-Rouge et des clochards qui s'amènent pour le petit déjeuner ; je n'ai pas de mal à faire illusion. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour un café chaud...
Enfin, je vais me poser au Silène qui vient d'ouvrir, vers les sept heures. Pour une nuit foireuse, c'est réussi, me dis-je en essayant de ne pas coller mentalement le visage de mon assistante sur les demoiselles de Serpieri. Quel sacré vieux pervers je fais... Au fait, je devrais laisser traîner ces vieilles BD sous son nez, au bureau. Ça lui donnera peut-être des idées...
Gatrasz. 5 commentaires
5 commentaires Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
[Primitif urbain] ' Stone Dead Tripper ' Scimmia...